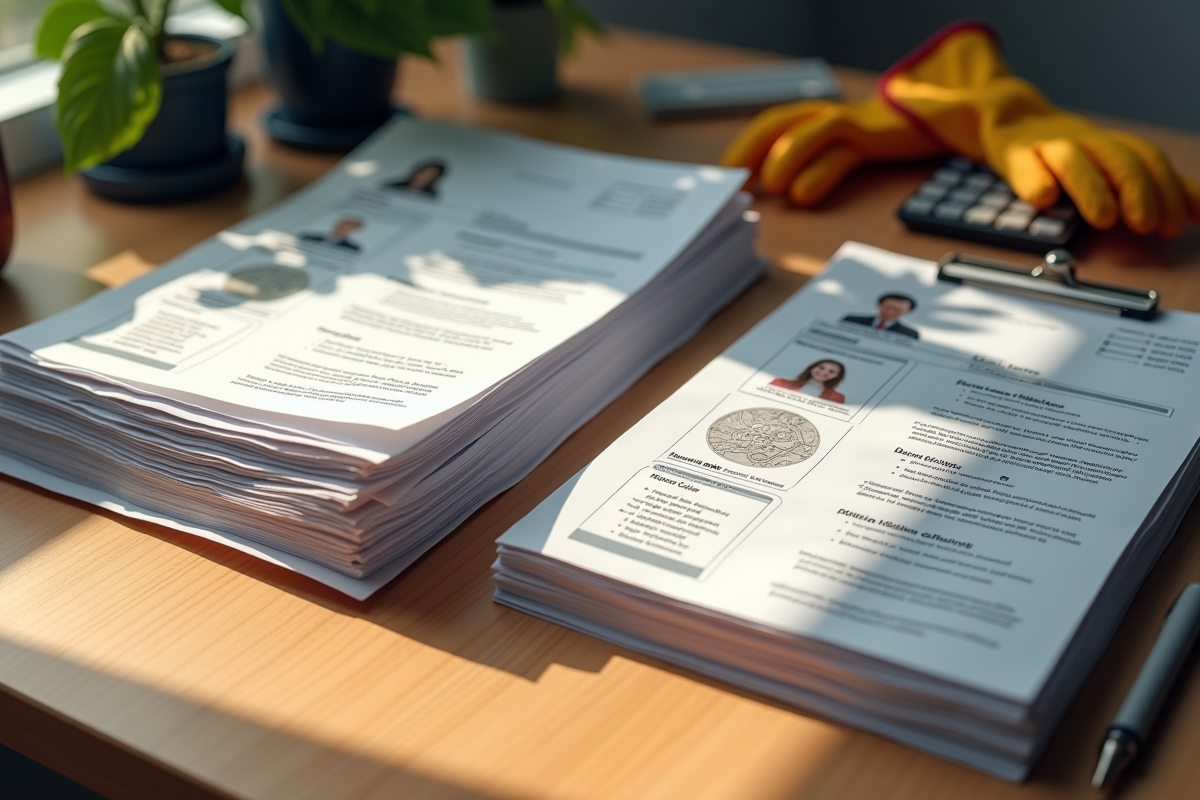Entre 1995 et 2015, la part des emplois intermédiaires a reculé de près de 10 % dans plusieurs économies avancées, alors que les postes très qualifiés et très peu qualifiés progressaient simultanément. Les entreprises informatiques recrutent davantage d’ingénieurs et de techniciens, pendant que le secteur des services multiplie les emplois à faible valeur ajoutée.
Cette recomposition du marché du travail modifie durablement les trajectoires professionnelles et complexifie l’adaptation des politiques publiques. Les écarts de salaire et de conditions d’emploi s’accentuent, avec des implications directes sur la cohésion sociale et la compétitivité économique.
Comprendre la polarisation de l’emploi : de quoi parle-t-on vraiment ?
La polarisation de l’emploi n’est pas un concept académique réservé aux économistes. C’est une réalité tangible, qui redessine la carte du marché du travail aussi bien en France qu’aux États-Unis. Depuis une vingtaine d’années, la structure des métiers se transforme : les emplois très qualifiés s’envolent, ceux à faible qualification s’étendent, tandis que la tranche intermédiaire s’efface lentement. Ce constat, on le doit aux analyses de David Autor, David Dorn, Maarten Goos, Alan Manning ou encore Anna Salomons. Leur verdict ne laisse pas place au doute : les créations de postes se concentrent désormais sur les deux extrémités de la hiérarchie des qualifications.
Cette définition de la polarisation de l’emploi s’appuie sur une double dynamique profonde. D’un côté, les emplois à forte valeur ajoutée, ingénieurs, spécialistes de la tech, cadres supérieurs, se multiplient, sous l’impulsion de l’innovation, du numérique et de la tertiarisation. De l’autre, les emplois peu qualifiés, souvent précaires, gagnent du terrain dans la logistique, les services à la personne ou la distribution. Entre ces deux pôles, les métiers intermédiaires, agents administratifs, techniciens, ouvriers qualifiés, voient leur présence diminuer. Ce mouvement s’accélère sous l’effet de l’automatisation des tâches standardisées et de la fragmentation accrue des chaînes de production.
Pour mieux comprendre cette dynamique, voici comment se répartissent aujourd’hui les principales catégories de métiers :
- Professions très qualifiées : leur progression s’appuie sur l’innovation et le développement des services sophistiqués.
- Professions intermédiaires : en chute, affectées par la rationalisation et les gains de productivité.
- Emplois peu qualifiés : stables, voire en légère hausse, mais marqués par la précarité et des salaires modestes.
La polarisation s’impose comme une force structurante : elle redéfinit aussi bien l’accès à l’emploi, la dynamique salariale que les parcours professionnels. Ce phénomène ne relève ni de l’accident, ni d’un simple effet de mode ; il s’enracine dans l’économie et replie la société sur des lignes de fracture, en France comme ailleurs.
Entre emplois qualifiés et peu qualifiés : une fracture qui s’accentue
Le quotidien du marché du travail illustre cette polarisation sur le terrain. Les professions très qualifiées, cadres, ingénieurs, experts, gagnent du terrain, grâce à la poussée des technologies numériques, de l’innovation et de la demande pour des services à haute valeur ajoutée. En parallèle, la part des emplois peu qualifiés ne faiblit pas, en particulier dans les métiers de la distribution, de la logistique ou de l’aide à la personne. Cette stabilité, voire cette légère progression, masque une réalité : ces emplois sont souvent précaires, exposés à la volatilité des contrats et à des rémunérations stagnantes.
Les professions intermédiaires, elles, se raréfient. Techniciens, ouvriers qualifiés, agents administratifs subissent de plein fouet l’automatisation, la dématérialisation et la standardisation des tâches. Les emplois routiniers disparaissent, remplacés par des fonctions plus abstraites ou manuelles, moins exposées à l’automatisation. À l’inverse, les métiers du soin, du social, de l’accompagnement à domicile profitent du vieillissement démographique et de l’évolution des besoins collectifs.
L’un des effets les plus visibles de cette recomposition, c’est la fracture salariale qui s’élargit. Les salariés des métiers très qualifiés accèdent à de meilleurs salaires et à des carrières évolutives. Ceux des emplois peu qualifiés restent enfermés dans la précarité et les rémunérations faibles. Aujourd’hui, le niveau de diplôme conditionne plus que jamais l’accès aux segments protégés du marché de l’emploi, reléguant les moins diplômés à des fonctions dévalorisées et souvent instables.
Quelles sont les causes et les conséquences sur le marché du travail ?
L’irruption massive des technologies de l’information et de la communication bouleverse la composition des effectifs. L’automatisation remplace les tâches répétitives, transformant en profondeur les métiers administratifs ou industriels. La demande s’oriente vers des profils dotés de compétences analytiques, créatives ou manuelles, qui résistent à la standardisation. C’est ainsi que la polarisation du marché du travail s’est imposée en France, sur le même modèle qu’aux États-Unis, avec des effets documentés par des économistes comme David Autor et Maarten Goos.
L’expansion du e-commerce et la digitalisation des services réduisent les emplois classiques de la vente, mais créent de nouveaux besoins dans la logistique, la livraison, la gestion de flux. Les métiers liés au soin et au travail social recrutent davantage, soutenus par le vieillissement de la population et l’évolution de la structure familiale.
Dans ce contexte, l’essor de l’emploi atypique s’intensifie : CDD, temps partiels, missions d’intérim se généralisent, surtout pour les emplois peu ou moyennement qualifiés. Cette segmentation s’aggrave lors des périodes de contraction économique, où les emplois routiniers disparaissent et les situations précaires se multiplient.
Voici deux réalités qui découlent directement de ces transformations :
- La reconversion reste difficile en France, faute d’une mobilité professionnelle suffisamment fluide.
- Le clivage s’accentue entre quelques salariés protégés par un CDI et une majorité qui alterne les contrats courts et l’incertitude.
Le chômage s’en trouve accentué : passer par une période d’inactivité augmente les chances de se retrouver dans un emploi atypique par la suite. La multiplication des statuts précaires fragmente les trajectoires, rendant les cheminements professionnels plus incertains et imprévisibles.
Réponses possibles : quelles politiques pour accompagner ces mutations ?
Face à cette polarisation, l’adaptation du système de formation devient une nécessité stratégique. Les compétences attendues évoluent vite, bien plus vite que ne le permettent les dispositifs actuels de formation continue. Il s’agit d’anticiper les transitions professionnelles, d’outiller les salariés dont les emplois routiniers disparaissent. Les parcours de formation doivent gagner en flexibilité, en rapidité, en adéquation avec la réalité du marché du travail.
L’assurance chômage doit aussi s’ajuster. Protéger les salariés passe autant par une indemnisation réactive que par un accompagnement sur mesure : conseils, validation des acquis, orientation ciblée. L’enjeu, c’est d’éviter l’enfermement dans la précarité et d’ouvrir l’accès aux métiers porteurs, qu’il s’agisse du soin, du social ou de la transition écologique.
Le système de protection sociale doit être repensé pour coller à la réalité du marché. Aujourd’hui, la dualité entre CDI et contrats courts ne suffit plus : la clé réside dans des droits attachés à la personne, indépendamment du type de contrat. France Stratégie, sur la base des analyses Insee-DGI, plaide pour des dispositifs plus souples, capables d’accompagner les mobilités professionnelles et de sécuriser les transitions.
Trois pistes se dessinent pour amorcer ce virage :
- Intensifier l’effort sur la formation tout au long de la vie.
- Redéfinir l’assurance chômage pour privilégier l’accompagnement actif et personnalisé.
- Faire évoluer la protection sociale vers des droits universels, transférables d’un emploi à l’autre.
La montée en puissance de l’emploi atypique et la transformation de l’organisation du travail forcent à inventer de nouveaux filets de sécurité. L’enjeu, désormais, ne se limite plus à garantir un emploi stable, mais à bâtir des trajectoires solides dans un univers professionnel mouvant. Reste à savoir si la société saura relever ce défi, ou si la fracture continuera de s’élargir sous nos yeux.